-
 chevron_right
chevron_right
Lectures russes.
bap · nsfw.movim.eu / BonjourMadame · Wednesday, 28 April, 2021 - 08:00

 chevron_right
chevron_right
Lectures russes.
bap · nsfw.movim.eu / BonjourMadame · Wednesday, 28 April, 2021 - 08:00

 chevron_right
chevron_right
Un mois de mars studieux et sexy.
bap · nsfw.movim.eu / BonjourMadame · Monday, 1 March, 2021 - 09:00

Greta a tué Einstein, de Jean-Paul Oury
Francis Richard · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Monday, 1 February, 2021 - 04:30 · 6 minutes
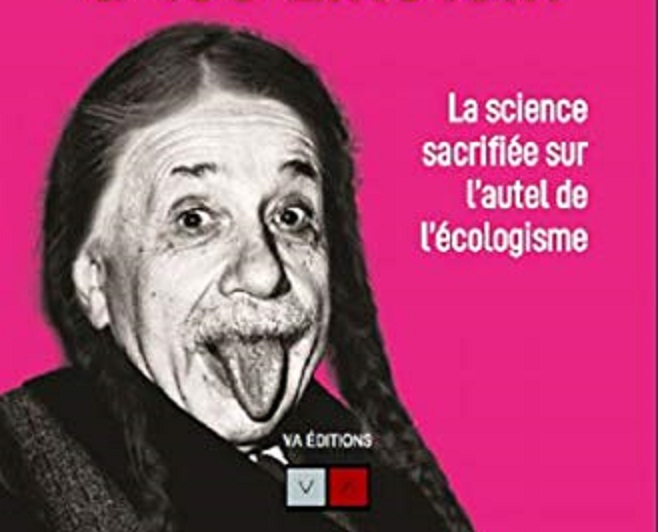
Par Francis Richard.
Pourquoi ce titre ?
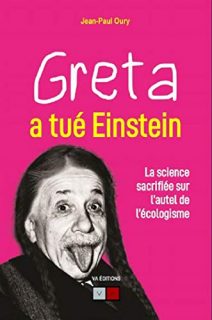 « Nous l’avons voulu suffisamment accrocheur pour marquer les esprits. En fait nous ne supposons pas un seul instant que la jeune Greta veuille faire du mal au vieil Einstein. »
« Nous l’avons voulu suffisamment accrocheur pour marquer les esprits. En fait nous ne supposons pas un seul instant que la jeune Greta veuille faire du mal au vieil Einstein. »
« C’est peut-être bien au contraire Einstein qui risque de tuer Greta… »
En effet, ce livre montre que la science et la technologie, combattues au nom de la science, en fait au nom de l’écologisme, par la jeune Suédoise, ne sont pas le problème mais la solution.
Greta et ses semblables traduisent devant leur tribunal quatre technologies présumées coupables : les OGM, l’énergie nucléaire, les mauvaises ondes, le glyphosate.
Il s’agit en réalité à chaque fois d’une manipulation de l’opinion qui utilise le même processus :
C’est bien sûr le principe de précaution qui est invoqué pour exiger ce risque zéro . Cette mise en scène et cette question sans réponse permettent en tout cas de discréditer lesdites technologies.
Peu importe que ce risque ne se soit jamais produit avec les OGM, que « le nucléaire civil soit à l’origine d’un bien moins grand nombre d’accidents que les autres sources d’énergies » , que les mauvaises ondes n’aient jamais produit que des maux invisibles et que le seul Centre International sur le Cancer s’en soit pris, et s’en prenne, au glyphosate qui serait cancérigène : « toutes les autres agences partout dans le monde » ne partagent pas cet avis.
Comme le souligne l’auteur, l’objectif de ceux qui s’en prennent à ces technologies est d’ « enterrer le progrès scientifique. »
A contrario les écologistes ne posent pas, et ne se posent pas, de questions pour ce qui concerne le bio , les éoliennes , la voiture électrique ou l’homéopathie pour la bonne raison qu’ils leur décernent le label made in Nature .
Pourtant, sur le bio, il existe de vraies histoires d’empoisonnement, que l’auteur ne se prive pas de raconter. L’une d’elles, la plus célèbre , se passe en 2011, dans une ferme allemande, et s’est terminée par 54 morts et 3000 personnes intoxiquées…
Les éoliennes tuent les oiseaux , sont bruyantes et ne produisent de l’énergie que par intermittence . En Allemagne , la continuité de la production d’énergie est assurée par des centrales polluantes, à charbon et à gaz…
Le véhicule électrique n’est pas un véhicule à zéro émission. De plus, le coût énergétique pour le construire est de trois à quatre fois celui d’un véhicule conventionnel, sans compter que, pour qu’il circule, il faut bien générer de l’électricité…
L’auteur s’en prend aux « autres médecines » labellisées (bien antérieures à l’écologisme et sans rapport avec lui) : qi gong, homéopathie, naturopathie, plantes, yoga, acupuncture etc. et se range derrière l’avis de Laurent Alexandre qui défend contre elles les « traitements scientifiques évalués ».
C’est le point le moins convaincant de l’argumentation. Car, à la fin de son ouvrage, l’auteur déplore que la séparation entre l’esprit et la matière ait rendu difficile l’expression du continuum entre l’Homme et la Nature, or, par exemple, le qi gong ou le yoga l’opèrent…
La société d’abondance alimentaire est fragile. La science peut en renforcer la sécurité par des avancées technologiques, telles que le séquençage du génome du blé, qui permet, par exemple, de lutter contre des maladies ou les sécheresses.
Encore faudrait-il que l’idéologie ne prévale pas en suscitant une « peur construite des solutions scientifiques et techniques » , une « peur systématique et indifférenciée de toutes les technologies quelles qu’elles soient » , par exemple :
D’aucuns, les collapsologues, annoncent l’effondrement de la société industrielle et font appel à la science pour ce faire, alors que ce sont la science et la technologie qui peuvent l’éviter. Eux et les adeptes de la décroissance , en fait, « œuvrent pour saper l’édifice de la science contemporaine » .
D’autres ne cachent pas leur haine de l’humanité. Ils font appel à la science « pour appuyer des messages catastrophistes » . Ils sont prêts à sacrifier l’humanité « sur l’autel du dieu Nature » . Et cela se traduit par la diminution souhaitée du nombre des êtres humains sur Terre , qu’ils voient comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique…
Après avoir souligné la montée au créneau de scientifiques contre l’écologisme, l’auteur donne les exemples d’écologistes qui se sont convertis à la science après l’avoir découverte et qui, du coup, ont compris tout l’intérêt du nucléaire civil et des OGM :
À partir de là, l’auteur parle de l’« agriculture de précision » , qui est respectueuse de l’environnement puisque :
Pour ce qui est de l’intelligence artificielle, il y voit un moyen d’assister l’Homme, notamment dans la prise de décision. Il combat les fantasmes à son sujet et s’en tient aux réalisations concrètes.
Enfin, il cite Marc Rameaux :
« La conscience humaine est capable de décider par elle-même de se placer « out of the box », ce qu’aucune IA ne sait faire. »
Enfin il ne voit pas d’opposition entre l’Homme et la Nature , comme le prétendent les écologistes : « L’entreprise humaine est davantage une tentative de se libérer du déterminisme et de la fatalité qu’un combat contre la nature. »
Il existe en revanche une opposition entre ceux qui ont une vision étroite de la nature, les écologistes adeptes de l’écologie politique et ceux qui en ont une élargie, les écologues, les scientifiques de l’environnement.
« L’homme, la science et la nature sont intimement liés. »
Pour que la confiance en la science revienne, il faut appliquer à toutes les innovations scientifiques et techniques, le label made in Nature puisque ce label, employé par le marketing vert, rassure l’opinion et qu’en l’occurrence il est pertinent.
—
« 40 ans d’égarements économiques » de Jacques de Larosière
Johan Rivalland · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Sunday, 24 January, 2021 - 04:30 · 8 minutes

Par Johan Rivalland.
Pour la petite anecdote, il se trouve qu’à la veille du premier confinement j’achevais presque la lecture du précédent ouvrage de Jacques de Larosière, intitulé Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier .
 Un ouvrage très bien fait, très pertinent et documenté, que j’ai regretté de ne pas avoir finalement présenté, l’actualité s’étant centrée quasi-exclusivement sur la terrible crise du moment, laissant peu de place à des sujets qui auraient alors peu intéressé sur l’instant (mais j’en recommande vivement la lecture).
Un ouvrage très bien fait, très pertinent et documenté, que j’ai regretté de ne pas avoir finalement présenté, l’actualité s’étant centrée quasi-exclusivement sur la terrible crise du moment, laissant peu de place à des sujets qui auraient alors peu intéressé sur l’instant (mais j’en recommande vivement la lecture).
Près d’un an après, le moment est venu de le présenter. Il établit un diagnostic éclairé sur la situation très dégradée de l’économie française après quarante années d’errements liés en bonne partie à la démagogie et au manque de courage politiques, puis propose des voies pour tenter de nous en sortir.
Le constat établi par Jacques de Larosière – homme rappelons-le au parcours absolument exceptionnel (qui a notamment dirigé tour à tour le FMI, puis la Banque de France, puis la BERD) – est sans appel. Celui d’ un pays profondément désindustrialisé , qui n’a cessé de glisser au bas des classements internationaux pour ses performances économiques. Tout en ayant massivement augmenté l’appareil d’État, les dépenses et les prélèvements publics.
Une situation encore aggravée, comme on le sait, par la crise du coronavirus, pour laquelle l’économie française partait avec de lourds handicaps, vu le montant de ses déficits et dettes et la résistance aux réformes structurelles, que beaucoup d’autres pays avaient su quant à eux engager bien avant. Facteurs qui l’ont rendue plus vulnérable que beaucoup d’autres.
Or, la fuite en avant dans la monétisation systématique, servie par les bas taux d’intérêt, nous fait vivre dans un leurre. Qui ne peut que nous rattraper.
Nous vivions dans l’illusion que, malgré nos déficiences, nous finissions toujours par nous en sortir et que, par mauvais temps, nous étions mieux protégés que les autres par un système social efficace. L’histoire récente ne corrobore pas cette vue des choses. Les pays qui se sont attachés à maîtriser leurs dépenses publiques et leurs soldes budgétaires apparaissent comme les gagnants : ils ont plus de marges pour réagir et s’apprêtent à conquérir de nouveaux marchés et à reprendre leur croissance. En revanche, les pays qui se sont habitués à la facilité, au keynésianisme mal compris, en prétendant que c’était « socialement juste », tout en dissimulant le coût social lié à l’insuffisance des réformes de structure, pourtant seules à même de faire repartir l’économie, se révèlent les perdants en matière de pouvoir d’achat et d’emploi.
Dans cet essai, Jacques de Larosière met ainsi en avant de manière méthodique et documentée les nombreux retards accumulés depuis 45 ans par notre économie, tout en suggérant les voies qui permettraient de les combler.
Croissance, Revenu par tête, Investissement, Niveau de vie par habitant, Taux d’activité, Productivité (avec notamment les 35 heures et la précocité de l’âge de départ à la retraite par rapport à nos voisins), Taux d’emploi, Balance commerciale, Balance des paiements courants, Endettement public, Taux de marge des entreprises : tous ces indicateurs sont au rouge si on les compare à leur évolution chez nos voisins.
Et pourtant, la France bénéficie d’ une démographie qui s’est renversée au cours du dernier siècle et est devenue très favorable comparativement à ses voisins. Ce qui en fait une opportunité à saisir pour engager la voie de l’avenir, pour peu qu’on se lance enfin dans les réformes en mesure de le permettre. Et c’est tout le propos du livre.
Encore faut-il que l’on s’attaque au premier des problèmes, lancinant en France, celui qui est à la base de tout : l’éducation . Non seulement, là encore, la France n’a cessé de régresser , mais malgré les sommes très importantes consacrées à l’Éducation nationale, les résultats sont médiocres et, qui plus est, producteurs d’inégalités .
Quant aux dépenses publiques, non seulement elles ont atteint le record du monde en pourcentage du PIB, mais surtout elles n’ont servi qu’à financer essentiellement les opérations courantes, et non l’investissement, ce qui est encore pire au regard de la préparation de l’avenir. Et les effectifs de la fonction publique ont progressé près de deux fois plus vite que la population active, sans que l’on parvienne jamais à les diminuer.
Jacques de Larosière établit beaucoup de comparaisons notamment avec l’Allemagne , permettant ainsi de mettre en évidence les écarts qui se sont creusés entre les deux. À ce titre, un point a attiré mon attention, révélant bien la différence fondamentale d’état d’esprit :
En France, le ministère des Finances arrête le montant des dépenses publiques (c’est là la « stratégie » du gouvernement) et, compte tenu des recettes fiscales attendues, le déficit en découle. Les dépenses ont leur propre dynamisme (par exemple le poids des intouchables « services votés » et les négociations du point d’indice des traitements de la fonction publique). En Allemagne, c’est au contraire la recette qui commande le processus. Une fois la recette arrêtée (à législation constante dans une perspective à cinq ans), la dépense doit s’ajuster aux ressources attendues, en vertu des dispositions constitutionnelles relatives au principe d’équilibre.
Une différence d’approche fondamentale, surtout quand on sait (et c’est ce qu’il démontre abondamment dans cet ouvrage) à quel point l’endettement grève la croissance économique et la compétitivité des entreprises d’un pays.
À chaque chapitre, et donc sur chaque question, y compris celle-ci en s’appuyant par exemple sur l’expérience suédoise ou, dans une moindre mesure portugaise d’avant crise, Jacques de Larosière propose une série de solutions. Tout en mettant en garde au passage contre les fausses recettes (du type « nouvelle théorie monétaire » ou effacement partiel des dettes), dont il démontre l’inanité.
En matière de marché du travail (taux de chômage, chômage des jeunes, productivité, coûts salariaux, salaires réels, poids des charges, question du salaire minimum, qualifications, indemnisations chômage, précarité, etc.), la comparaison avec l’Allemagne est, là encore peu flatteuse. Et grâce à l’analyse, propice à en tirer de nombreux enseignements.
Quant aux retraites, enjeu majeur de société, Jacques de Larosière montre comment la compréhension des données essentielles, notamment démographiques, a été mal appréhendée, aboutissant à un coût faramineux pour des résultats catastrophiques. En la matière, nous sommes dans le déni, ce qui débouche sur des tentatives de réformes mal orientées et mal menées.
Revenant en détail sur les différentes données et sur les faiblesses des différents scénarios privilégiés, il suggère à la fois une hausse de l’âge de départ à la retraite, solution de loin la moins indolore et la plus facile et rapide à mettre en œuvre (plutôt que l’unification, qui est source de divisions), dans le cadre du système par répartition (qu’il se garde de remettre en cause radicalement), accompagnée d’un encouragement au développement beaucoup plus significatif de l’épargne retraite complémentaire, notamment fonds de pension, pour ouvrir la voie à une part croissante de capitalisation .
Par ailleurs, le système de redistribution français fait de la France l’un des pays les moins inégalitaires, au prix d’un accroissement du taux de pauvreté et d’une économie insuffisamment productive, qui pèse sur l’évolution du revenu par habitant.
Avant redistribution, la France est au contraire l’un des pays les plus inégalitaires, en grande partie du fait de son taux de chômage. Et la situation depuis le Covid-19 accentue très nettement les clivages.
En conclusion, Jacques de Larosière montre que le retard français provient essentiellement du centralisme administratif et politique. Là où le principe de subsidiarité , à la base de tout régime fédéral, se montre bien plus efficace.
À quoi s’ajoutent l’excès de dépenses publiques, les sureffectifs de notre fonction publique et le fonctionnement de notre système de retraites. Le tout gangréné par l’incapacité des politiques à mener les réformes structurelles qui s’imposent, par excès de facilité et de démagogie , mais aussi en raison du poids de la bureaucratie .
Sans oublier la responsabilité des médias, au sujet desquels Jacques de Larosière écrit ceci :
Quant aux médias, ils sont, sauf exceptions, assez mal informés des questions économiques, et surtout de leurs perspectives d’ensemble. À quelques exceptions près, ils sont souvent tentés de privilégier les « petites phrases », le « microcosme », les scandales, par rapport aux problèmes de fond. À l’opposé, certains grands quotidiens économiques anglo-saxons sont d’une qualité remarquable et nourrissent le débat public.
En définitive, écrit-il, on pourrait dire que la France a appliqué en négatif tout l’inverse de ce que décrit Edmund Phelps dans La Prospérité de masse .
Relire 1984 de George Orwell en temps d’épidémie
Francis Richard · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Friday, 22 January, 2021 - 04:35 · 5 minutes

Par Francis Richard.
En fin d’année 2020, les éditions Gallimard ont eu la bonne idée de publier des œuvres de George Orwell dans leur célèbre Bibliothèque de la Pléiade.
Parmi les œuvres de ce volume, il y a Hommage à la Catalogne (et aux anarchistes persécutés par les communistes), et La Ferme des Animaux . C’est dans ce roman-ci que George Orwell a écrit cette phrase sublime et profonde :
Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que les autres…
Relire 1984 en temps d’épidémie de Covid-19 incline le lecteur à la tentation de l’appeler dorénavant Covid-1984 … en hommage à l’écrivain britannique.
En effet, au-delà du récit romanesque, dont le héros est Winston Smith, se concrétise dans ce roman La Tentation totalitaire que décrivit Jean-François Revel en son temps (1976), et qui semble séduire aujourd’hui les États occidentaux, profonds ou pas.
Dans le socialisme anglais – Socang – décrit par George Orwell, il existe trois catégories de personnes : les membres du Parti intérieur, ceux du Parti extérieur et les prolétos, c’est-à-dire les prolétaires (85 % de la population).
Dans cette société collectiviste et hiérarchisée, seuls les prolétos et les animaux sont libres , parce qu’ils sont sans importance, maintenus qu’ils sont par le Parti dans l’ignorance et la pauvreté :
L’inégalité économique a été rendue permanente.
Pour être bien sûr que le progrès technologique ne puisse pas leur être bénéfique, les trois super-États qui se partagent le monde se font la guerre en permanence ou prétendent se la faire.
(le lecteur fera inévitablement un rapprochement avec la guerre permanente menée contre un virus qui a la bonne idée de ne pas être visible)
Il s’agit bien d’un monde socialiste puisque les usines, les mines, les terres, les maisons, les transports ont été enlevés des mains des capitalistes et relèvent désormais de la propriété publique.
(certes ce but n’a pas encore été atteint dans nos sociétés occidentales, mais c’est bien l’objectif que se sont donné les États, qui le réalisent peu à peu par les impôts et les réglementations)
Au contraire des prolétos , les membres du Parti sont surveillés de manière permanente par télécrans chez eux et en dehors de chez eux par micros. Ce qu’aucun gouvernement n’avait fait jusque-là, le Parti l’a donc fait.
(il est possible de surveiller tout le monde en Occident grâce aux téléphones mobiles et aux réseaux sociaux…)
De ses membres, le Parti, cette oligarchie collective , exige qu’ils accordent les contraires pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Ces contraires se résument en trois mots : dangerdélit , noirblanc et doublepense , qui est le plus important :
Doublepense désigne la capacité d’avoir dans le même esprit en même temps deux convictions antithétiques et de les accepter l’une l’autre.
(le lecteur reconnaîtra le en même temps cher à Emmanuel Macron)
La structure du pouvoir reflète cette vision du monde et de mode de vie : le ministère de la Paix s’occupe de la guerre ; le ministère de la Vérité, des mensonges ; le ministère de l’Amour est chargé de la torture ; et celui de l’Abondance, de la famine .
(en temps d’épidémie nos ministères de la Vérité traquent les fake news dont ils sont – doublepense – les principaux producteurs…)
La personnification du Parti, c’est le Grand-Frère , qui, tel Dieu, vous surveille – Big Brother is watching you . Il vous est impossible de le haïr, vous ne pouvez que l’aimer, sinon vous êtes un fou qu’il faut guérir de sa maladie mentale :
Nous allons vous vider de ce que vous êtes, puis nous vous emplirons de nous-mêmes.
Car la réalité existe dans l’esprit humain, nulle part ailleurs . Elle n’est pas dans l’esprit d’un individu, qui peut se tromper, et en tout cas est voué à périr, mais dans l’esprit du Parti, qui est collectif et immortel .
(Emmanuel Macron a déclaré le 14 octobre 2020 : Nous sommes en train de réapprendre à devenir une nation. On s’était progressivement habitués à être une société d’hommes libres, nous sommes une nation de citoyens solidaires .)
Dans le roman de George Orwell, un membre éminent du Parti explique à Winston Smith que le bien des autres ne nous intéresse pas ; seul nous intéresse le pouvoir . Voyant qu’il faut mettre les points sur les i, il ajoute :
Vous devez d’abord comprendre que le pouvoir est collectif. L’individu n’a de pouvoir que dans la mesure où il cesse d’être un individu.
Il reconnaît même que le pouvoir réside dans la capacité d’infliger souffrance et humiliation… et que la raison [est] affaire de statistiques…
(les réprimés de tous les pays au nom de l’épidémie l’ont compris et le Grand Frère aurait été ravi par les litanies de chiffres égrenés chaque soir dans les journaux télévisés…)
Dans le roman de George Orwell, les gens ne lisent plus. Comme on dirait aujourd’hui, ce n’est pas essentiel . Ce qui importe au Parti, c’est qu’ils ne pensent pas et le meilleur moyen est encore de s’attaquer à la langue.
Dans un appendice, l’auteur approfondit le concept. S’il ne fallait retenir que deux aspects de cette langue nouvelle destinée à abêtir les individus, ce serait que les mots y sont abrégés et que le vocabulaire y est réduit :
On comprit qu’en abrégeant ainsi un mot, on restreignait et on altérait subtilement son sens, le dépouillant de la plupart des connotations qui dans sa forme complète, lui seraient restées attachées.
Moins on disposait de mots, moins on était tenté de penser.
« Les péchés secrets de la science économique » de Deirdre McCloskey
Johan Rivalland · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Saturday, 16 January, 2021 - 04:30 · 9 minutes

Par Johan Rivalland.
Les économistes sont régulièrement accusés de maux divers, dont ils se montreraient les coupables. Produire des modèles prédictifs qui ne prédisent rien ou se trompent fréquemment, produire des analyses qui n’expliquent rien, qui manqueraient d’humanité, etc.
 Par ce petit essai stimulant, Deirdre Mc Closkey tente de prendre la défense d’une discipline au sujet de laquelle règnent trop de malentendus et qu’il est utile d’interroger.
Par ce petit essai stimulant, Deirdre Mc Closkey tente de prendre la défense d’une discipline au sujet de laquelle règnent trop de malentendus et qu’il est utile d’interroger.
Ce petit livre est organisé en quatre parties dont nous reprendrons les intitulés en guise de sous-parties.
L’auteur commence par porter un regard critique sur la quantification. Si celle-ci est très souvent parfaitement utile, l’obsession en la matière ne doit pas non plus aller trop loin. Et les excès peuvent être nombreux. L’objectif pouvant être, par exemple, en Economie comme dans d’autres sciences, d’aspirer à la scientificité.
Or, les chiffres ne suffisent pas à amener un regard « objectif » ou « non politique » sur les choses ou sur des événements. Il ne faut pas perdre de vue que « les chiffres relèvent de la rhétorique, c’est-à-dire qu’ils ont vocation à convaincre des auditeurs », à persuader de quelque chose.
Cependant, dans de nombreux cas ils sont absolument essentiels, car ils permettent de mieux éclairer un problème ou un phénomène, ou de le situer plus clairement dans un contexte. En cela, Deirdre Mc Closkey conclut que « compter n’est donc pas un péché de l’économie, mais plutôt une vertu ».
L’auteur montre ensuite, non sans une bonne dose d’humour dans les explications, que les mathématiques, quant à elles, ne répondent pas à la question « Combien ? », mais « Pourquoi ? ».
Ainsi, l’avantage du libre-échange, à partir de certains axiomes de base, peut être démontré de manière aussi incontestable que le théorème de Pythagore. Sans que l’on cherche nécessairement à répondre à « Combien ? », ce qui est une autre question.
Nous sommes là dans le raisonnement qualitatif, et non quantitatif. Et dans une démarche déductive, et non inductive. Il s’agit même d’un raisonnement de type philosophique, affirme l’auteur. Qui rejoint ainsi les raisonnements du type de ceux de David Hume en Ecosse ou des Physiocrates en France vers la moitié du XVIIème siècle.
A propos du raisonnement inductif, à l’inverse, Deirdre Mc Closkey rappelle que « la validité d’un calcul dépend des données et des suppositions ». Ce qui explique parfaitement la mise en cause de conclusions statistiques jugées fausses. L’auteur en conclut, là encore, que « les mathématiques ne sont donc pas non plus un péché de la science économique, mais bien plutôt, en elles-mêmes, une vertu ».
Concernant maintenant le libéralisme, l’auteur tente là encore de montrer qu’il est envisageable de le considérer comme une vertu, même si tous les économistes ne sont pas libre-échangistes, ceux qui ne le sont pas étant « souvent européens, et aujourd’hui presque toujours français ». Tentant de montrer l’intérêt du « laissez faire », elle écrit ceci :
Ne comptez pas sur l’Etat pour résoudre vos problèmes, disait Adam Smith. Ce qu’il ne disait pas, c’est que faire appel à l’Etat revient à confier au renard la charge du poulailler. Ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui l’exercent : telle est la règle d’or. Inutile, donc, d’espérer qu’un gouvernement dirigé par des hommes viendra en aide aux femmes, ou qu’un gouvernement dirigé par des cadres d’Enron viendra en aide aux salariés d’Enron.
A travers quelques pages joyeusement délirantes, l’auteur poursuit en renforçant encore ironie et second degré. A tel point que, si on y ajoute l’humour américain, que je ne comprends pas toujours, je reconnais ne pas avoir vraiment perçu l’idée essentielle, que je me garderai donc de risquer de dénaturer.
Il est question de l’excès d’exclusivité accordé par la plupart des économistes aujourd’hui à des modèles « Prudents » de l’économie (variables « P » : Prudence, Prix, Profit, Propriété, Pouvoir), négligeant les variables « S » (Solidarité, Sociabilité, Sagas, Scrupules, Sacré). Extrait :
De nombreux économistes connaissent une évolution du même type : tenants de la Prudence durant leurs années de Master (surtout les garçons), ils en viennent à comprendre, aux environs de la cinquantaine, qu’en réalité les gens ont d’autres motivations que la seule Prudence (…) A tout ceci, l’économiste universitaire qui n’a pas dépassé la version « Master » de la science économique répondra sans doute, fidèle à son modèle exclusivement prudentiel : « Merci du conseil, mais il se trouve que je mène une existence très confortable en me spécialisant dans les variables P. » Son péché est une variété particulièrement égoïste de la Tour d’ivoire. « Pourquoi faudrait-il que je m’intéresse à l’argument dans son ensemble ? Je m’en tiens à ma spécialité ».
Cette partie a particulièrement retenu mon attention. Deirdre McCloskey y déplore l’ignorance « institutionnelle » du monde de la part de la plupart des économistes, qui omettent ou refusent de mener des recherches de terrain dans le monde des affaires dont ils dissertent. Privilégiant plutôt des modèles mathématiques et de « Prudence exclusive ». De même que l’économiste moyen souffre d’une « incroyable Ignorance Historique ».
Dans les années 1970, puis dans les années 1980, les programmes universitaires ont renoncé à exiger des étudiants qu’ils connaissent un tant soit peu le passé économique (…) A la même époque, la quasi-totalité des programmes de cycles supérieurs aux Etats-Unis (et mon cher Harvard a compté parmi les premiers à le faire) renonçaient à étudier l’histoire de la science économique elle-même. Des gens qui se disent économistes peuvent donc n’avoir lu aucune page d’Adam Smith, de Karl Marx ou de John Maynard Keynes. Autant imaginer un anthropologue qui n’aurait jamais entendu parler de Malinowski, ou un chercheur en biologie évolutive qui n’aurait jamais entendu parler de Darwin.
De même, l’auteur met en cause « l’Impéritie Culturelle » des économistes, plus répandue encore. « Rares sont les économistes qui lisent autre chose que des livres d’économie » et en dehors des ouvrages de mathématiques et de statistique appliquée, leur horizon paraît bien limité pour des gens qui prétendent aider à diriger un pays.
Là encore, c’est non sans humour qu’elle livre des anecdotes croustillantes tout aussi valables dans d’autres domaines que l’économie (d’où le titre de partie). Et montre le caractère inepte de certains présupposés d’économistes, dont la version « scolaire » du positivisme qu’ils énoncent mettent tout simplement à mal leur raisonnement. Si l’ensemble des propos peuvent sembler assez féroces, l’auteur n’en oublie par contre jamais l’auto-dérision. Ce qui rend la présentation très vivante.
Deirdre McCloskey en arrive alors à ses véritables griefs à l’encontre de la manière dont est trop souvent traitée la science économique.
Vous en conviendrez : une investigation du réel doit à la fois rechercher et réfléchir. Elle doit observer et théoriser. Formaliser et archiver. Les deux à la fois.
Or, nous montre l’auteur, trop nombreux sont ceux qui s’en tiennent à la pensée pure (mathématique ou philosophique) ou, à l’inverse, s’en tiennent à l’observation pure et non théorisée. Là où les deux sont complémentaires.
Et c’est ainsi qu’en appliquant des théorèmes, il suffit de changer les suppositions pour modifier les conclusions. Ce qui aboutit à pouvoir montrer tout et son contraire. Cette pure pensée, qualitative, et non quantitative, aboutit à des résultats qui, somme toute, ne sont que pure spéculation. Un « simple jeu intellectuel ».
L’auteur en apporte des exemples éloquents, qui ne sont pas sans me faire penser au passage à la manière dont certains érigent des hypothèses en matière de réchauffement climatique , pour en arriver à des scénarios qui varient du tout au tout et dont les plus pessimistes ont l’heur d’attirer l’intérêt des médias (et pas seulement), toujours friands de sensationnel.
Montrant que les économistes empiriques eux aussi se laissent abuser par les « résultats » qualitatifs (de la même manière que c’est le cas dans le domaine de la médecine, dont des exemples éloquents sont également apportés, ou des sciences sociales, et même de la biologie des populations), l’auteur ajoute :
Le péché semble improbable, car l’économie empirique est saturée de chiffres – mais il apparaît que ces chiffres, obtenus avec les outils les plus sophistiqués (et non plus les plus ordinaires, comme la simple énumération et les systèmes de comptabilité) sont dépourvus de sens (…) Déterminer si une chose compte ou non, c’est une affaire humaine ; les chiffres représentent des choses, mais une fois qu’on les a recueillis, c’est à nous, en dernière analyse, qu’il revient de déterminer s’ils comptent ou non. La pertinence n’est pas inhérente aux chiffres.
Cette affirmation relève du bon sens Elle n’a rien de subtil ; elle n’est pas discutable. Or elle semble décontenancer totalement des milliers de scientifiques, dont la quasi-totalité des économistes modernes.
Et, concluant avec panache ce petit pamphlet truffé d’humour et d’ironie, mais surtout de dépit, Deirdre McCloskey conclut sur les excès de formalisation et de binarité dans laquelle la science économique s’est selon elle engoncée irrémédiablement, jusqu’à l’absurde.
Théorie et recherche empirique recherchent ici des machines à produire des articles publiables. Et elles y parviennent, depuis que Samuelson s’est fait le champion d’une sorte d’avarice intellectuelle. La mauvaise science – celle qui utilise les théorèmes qualitatifs sans le mordant du quantitatif, et la signification statistique sans le mordant du quantitatif – a fini par chasser la bonne.
Jamais de guerre civile le mardi, par Yves Bourdillon
Frédéric Mas · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Friday, 15 January, 2021 - 04:35 · 2 minutes

Par Frédéric Mas.
Le décor planté, c’est celui de la France d’aujourd’hui, dans toute sa décrépitude. Dans certains quartiers qui jouxtent la capitale, les tensions entre la police et les caïds sont plus que palpables. Les signes d’avant-guerre civile brouillent les cartes, le climat se dégrade et le cœur de Paris n’est pas épargné.
Pour Fred Baumont, journaliste à La Ligne , les problèmes commencent quand disparaît sa collègue dans un de ces quartiers pourris où il ne fait pas bon se promener en jupe quand on est une femme. Scarlett, puisque c’est d’elle dont il s’agit, n’a pas sa langue dans sa poche. Progressiste et bobo, elle passe son temps à s’enguirlander avec Bob, l’autre collègue réac et pessimiste de Fred.
Là où Scarlett célèbre l’ouverture à l’autre et l’idéal cosmopolite, Bob voit la progression de l’islamisme radical dans les quartiers et la partition du pays qui vient. Au milieu, Fred, plutôt libéral tendance Tocqueville , fait tampon. Ses collègues l’agacent, mais ce sont de vrais pros.
Sa vie personnelle est aussi déglinguée que la France qui lui rappelle ses reportages de guerre. Il va tâcher d’y mettre de l’ordre, mais n’en dévoilons pas plus aux futurs lecteurs. Le dernier roman d’ Yves Bourdillon est un roman noir et drôle, où la fiction s’inspire d’une réalité de terrain qu’il arpente tous les jours depuis maintenant près de 20 ans en tant que journaliste aux Échos . Mais si son expérience de reporter lui donne la matière, c’est Frédéric Dard, Michel Audiard, ADG ou Manchette qui donnent le ton. Le réalisme presque brutal des situations est contrebalancé par un humour mordant, une réflexion désabusée mais jamais cynique.
Yves Bourdillon aime son métier et les personnages qu’il peint sont attachants, malgré leurs fêlures, leurs excès ou leurs défauts. Le style est haché, percutant, et n’a pas le temps d’ennuyer le lecteur. Il est pris dans une action du début à la fin du roman qu’il ne lâche qu’avec regret. Et puis il s’aperçoit que la France d’aujourd’hui ressemble beaucoup à celle décrite par Yves Bourdillon. En beaucoup, beaucoup moins drôle. À acheter donc d’urgence.
Yves Bourdillon, Jamais de guerre civile le mardi , éditions Millighan, 2020, 364 pages, 18, 90 euros.
L’almanach de Naval, guide indispensable du sage de la Silicon Valley
Nils Baudoin · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Wednesday, 13 January, 2021 - 03:30 · 4 minutes

Par Nils Baudoin.
L’almanach de Naval aussi surnommé Navalmanack est un assemblage d’écrits de l’entrepreneur et investisseur Naval Ravikant réalisé par Éric Jorgensen. Naval Ravikant, souvent appelé simplement Naval, est passé en quelques années d’entrepreneur reconnu à sage de la Silicon Valley.
Jorgensen a réalisé cet ouvrage à partir de tweets ( @naval est suivi par 1,1 million de lecteurs), d’articles, d’entretiens écrits ou en podcast ou encore de son propre podcast . Le livre est donc une suite de citations rigoureusement sourcées.
La préface est écrite par son ami Timothy Ferriss qui indique faire une exception à son principe de refuser d’écrire des préfaces. Le livre commence par des éléments biographiques racontés par Naval, notamment son enfance dans une famille modeste, à New Delhi puis à New York dans le Queens. Sa carrière y est aussi évoquée avec par exemple son investissement dans Uber en 2010 à l’âge de 34 ans.
Parmi les éléments importants de la première partie, consacrée à la création de richesse, on peut y noter :
– Le long terme , la responsabilité et les intérêts composés qui en découlent et pas uniquement sous forme financière.
– L’ importance des leviers ( leverage ), au nombre de trois selon Naval :
Ce dernier levier, le plus récent, est celui qu’il recommande. Il prend comme exemple l’animateur de podcast Joe Rogan . L’important pour réussir est de trouver des activités dans lesquelles l’ampleur du résultat peut être indépendante des entrées ; par exemple, un employé de support téléphonique ne peut traiter que les appels reçus alors qu’un animateur de podcast ou un auteur de logiciel n’a pas cette limite.
Cette partie est dérivée d’une suite de tweets intitulée How to Get Rich (without getting lucky) qui avait été très appréciée en 2018.
How to Get Rich (without getting lucky):
— Naval (@naval) May 31, 2018
– Comment rester indépendant en évitant de s’accrocher à une identité. Par exemple, quelqu’un se considérant comme « un conducteur de voiture de telle marque » ne va pas faire un choix indépendant et rationnel lorsqu’il voudra changer de véhicule. Ceci s’applique d’autant plus pour des identités plus vastes comme démocrate, catholique, américain qui poussent à des décisions davantage issues de l’habitude et du conformisme que du raisonnement… qui peuvent d’ailleurs amener au même résultat.
– L’ importance de la lecture : ne pas avoir peur de juste parcourir un livre pour en tirer l’essentiel, utiliser son temps sur les meilleurs livres et en particulier les classiques en commençant par les bases ; en économie par exemple, il recommande Adam Smith , Mises et Hayek .
– Les modèles mentaux : le titre de l’ouvrage peut d’ailleurs être vu comme une référence au Poor Charlie’s Almanach écrit sur le même principe à propos de Charlie Munger, le partenaire de Warren Buffet, grand promoteur des modèles mentaux, des heuristiques pour penser et décider plus efficacement ; à ce sujet, Naval recommande le site Farnam Street .
Dans la seconde partie, Naval présente le bonheur comme un choix et une compétence pouvant être développée. Il est inspiré par le bouddhisme sous une forme qu’il nomme bouddhisme rationnel en sélectionnant les enseignements qui marchent pour l’aider et qu’il peut rationaliser grâce à la science et l’évolution.
La compétence bonheur ne sera pas développée par tous de la même façon mais prendre des bonnes habitudes est nécessaire. Il est important de s’engager dans des jeux à somme positive plutôt qu’à somme nulle comme le statut, le monde politique ou universitaire. Il donne aussi des conseils plus pratiques en matière de nutrition (régime cétogène et jeûne), d’exercice physique (il s’entraîne avec Jerzy Gregorek, auteur de The Happy Body ) et de méditation.
Le livre se termine par une longue et éclectique liste de recommandations de lectures tant en fiction qu’en non-fiction.
L’ouvrage existe en format papier mais des versions PDF, web et ebook sont disponibles gratuitement sur le site .
Il est écrit en anglais et une traduction française est peu probable. Néanmoins, le style de Naval et l’origine de ses écrits (tweets, entretiens), le rendent très facile à lire même sans grandes compétences en anglais.
Le livre est illustré par des petits schémas minimalistes de Jack Butcher.
Éric Jorgensen a réussi à produire un ouvrage de lecture agréable qui ne donne pas l’impression d’être une compilation. On peut espérer que lui-même ou d’autres auteurs reprennent ce principe pour des penseurs contemporains dont la production est similairement fragmentée dans des formats divers.
Responsabilité : au cœur de la tradition intellectuelle libérale
Frédéric Mas · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Tuesday, 29 December, 2020 - 04:15 · 6 minutes

Un entretien réalisé par Frédéric Mas.
Un entretien exclusif avec Alain Laurent à propos de son dernier ouvrage : Responsabilité – Réactiver la Responsabilité Individuelle , paru le 7 février aux éditions Belles Lettres.
Frédéric Mas : Qui est responsable ? Être responsable, c’est être à soi sa première cause. Cela implique qu’il n’y a de morale qu’individualiste ?
Alain Laurent : Puisque dans l’ordre humain seul l’individu (et non pas les « collectifs ») est un être pensant et doté d’intentionnalité agissante, il est donc forcément seul à pouvoir être tenu pour responsable de ses choix et actions : être considéré comme leur cause principale et avoir à répondre de ce qui lui est imputé.
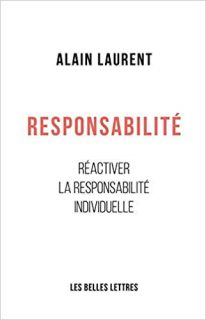 La responsabilité individuelle se situe donc à la fois en amont, dans le libre arbitre , de la prise de décision et en son aval, en assumant ou revendiquant les conséquences de ses décisions. S’il n’était pas le libre auteur de de ses actes, on ne voit d’ailleurs pas au nom de quoi on lui demanderait d’en rendre compte !
La responsabilité individuelle se situe donc à la fois en amont, dans le libre arbitre , de la prise de décision et en son aval, en assumant ou revendiquant les conséquences de ses décisions. S’il n’était pas le libre auteur de de ses actes, on ne voit d’ailleurs pas au nom de quoi on lui demanderait d’en rendre compte !
De ces considérations découle une éthique de la responsabilité individuelle qu’on peut en effet qualifier d’individualiste au sens classique de la notion d’individualisme , telle qu’elle est par exemple spécifiée dans le Trésor de la langue française (CNRTL – CNRS) qui fait autorité en la matière : ce qui privilégie l’indépendance d’esprit et de décision de l’individu ainsi que sa capacité d’autonomie ou d’autodétermination – à rebours de l’actuel individualisme bashing cher au gauchisme ou au conservatisme réactionnaire qui le réduit et l’assimile au narcissisme, à l’égoïsme trivial ou l’asocialité…
La France n’est pas un pays très libéral, mais vous estimez qu’un vrai déclin de la responsabilité culturelle et institutionnelle s’est amorcé après-guerre. Quelles en sont les sources ?
Le reflux de l’inscription institutionnelle du primat de la responsabilité morale et sociale de l’individu et sa déresponsabilisation subséquente ont en effet véritablement commencé en France aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, et cela à un double égard.
D’une part, sur le plan juridique, avec dans certains domaines la substitution d’une abstraite « personne morale » aux personnes humaines concrètes dans l’imputation des fautes commises et des réparations aux victimes (un point admirablement repéré, documenté, analysé et déploré en 1965 par l’éminente juriste Geneviève Viney dans son bien nommé Le déclin de la responsabilité individuelle ).
Et d’autre part avec la mise en place d’ un État social ou providence impliquant une déresponsabilisation croissante des individus dans la protection contre la maladie ou le chômage et la préparation de leur retraite (en France, cela s’est traduit par l’application du programme à fort relent collectiviste du Conseil national de la Résistance) : cette mise sous tutelle a été en son temps dénoncée par des penseurs libéraux de sensibilités diverses : Walter Lippmann , Jacques Rueff et surtout Wilhelm Röpke , que j’ai fréquemment cité dans mon livre.
Vous montrez bien que la responsabilité individuelle est au cœur de la tradition intellectuelle libérale. Cependant, c’est Proudhon qui pour vous est le premier à mettre en avant cet aspect dans son projet philosophique. Il serait le premier libertarien d’extrême gauche… Avant Bastiat ?
L’apparition de l’expression « responsabilité individuelle » constitue dans l’histoire des idées un marqueur lexical fort pour repérer l’émergence d’une philosophie morale et sociale centrant l’imputation de responsabilité sur l’individu.
Elle est intervenue dans le courant du XIXe siècle, avant tout en France ; et de l’enquête généalogique que j’ai menée il ressort que le premier penseur à l’avoir utilisée et positivement et à plusieurs reprises est… Proudhon – mais il s’agit du Proudhon d’après 1848-50, qui avait rompu avec le socialisme et rejoint la pensée libérale sur bien des points (libre concurrence, critique de l’impôt, respect du droit de propriété). En cela et sur le fond, il se rapproche de Bastiat avec qui il avait tant polémiqué et qui, paradoxalement venait de décéder (1850) mais n’avait, lui, jamais explicitement parlé de « responsabilité individuelle » bien qu’il ait été, cette fois-ci le premier à exposer sur un mode consistant les ressorts et la logique de la responsabilité de l’individu.
Que cela fasse de Proudhon dans la deuxième partie de sa trajectoire intellectuelle un « libertarien d’extrême gauche », je n’irai pas jusque là. J’ai depuis longtemps toujours vu en lui plutôt un radical et authentique libéral de gauche .
La responsabilité individuelle, et son pendant, le libre arbitre, n’est pas seulement menacée par les différents collectivismes de droite et de gauche qui cherchent à la diluer. L’émergence récente des neurosciences remet aussi au goût du jour le déterminisme matérialiste le plus extrême, qui tend à réduire la conscience de nos actions à néant. Comment surmonter ce néoscientisme sans pour autant rejeter les évolutions certaines de la science dans le domaine de la conscience ?
La critique fondamentale à adresser à nombre de neuroscientifiques décrétant, en invoquant leurs travaux, l’enterrement d’un libre arbitre (pour eux une antique superstition « métaphysique ») ou « free will » qui est le socle d’une substantielle et cohérente responsabilité individuelle, est de s’aventurer inconsidérément et péremptoirement hors de leur champ scientifique de compétence. D’autant qu’ils le font de manière expéditive, en croyant le liquider définitivement en quelques pages voire quelques lignes, ce qui est bien léger pour une problématique d’une complexité telle qu’elle leur échappe.
En se comportant de la sorte, ces suppôts d’un déterminisme réducteur et sommaire contreviennent aux rigoureux critères de la scientificité telle que les a avec soin posés Karl Popper : les extrapolations qu’ils avancent sans prudence ni parfois cohérence ne sont pas « falsifiables » (réfutables), et relèvent bien plutôt de l’opinion et de convictions idéologiques.
La moindre des choses serait qu’ils renoncent au prétendu monopole de l’explication cognitive de la vie morale de l’être humain, qui plus est réduit à l’état d’un automate irresponsable qui s’ignore. J’ajouterai enfin que l’existence non niable d’un « inconscient cognitif » peut être interprétée de manière toute différente, sans revêtir la toute-puissance liberticide qu’ils lui attribuent dans une grave rechute scientiste. C’est le cas d’autres neuroscientifiques et non des moindres, pour lesquels inconscient cognitif et libre arbitre sont compatibles.
Certains d’entre eux, dans le sillage d’un Karl Popper (qui fut d’abord un scientifique) acquis à l’indéterminisme, soutiennent même que la plasticité des déterminismes de l’esprit humain les rend ouverts à l’action d’une libre volonté – ou que dans l’état actuel des connaissances, la question est indécidable. Avec ceux-là, non seulement le dialogue est possible, mais nécessaire et fécond.
Un entretien initialement publié le 11 février 2020.