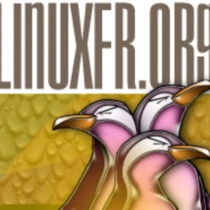-
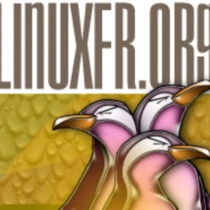 chevron_right
chevron_right
1 an en véhicule électrique uniquement
news.movim.eu / LinuxFRJournaux • 7 April • 8 minutes
Sommaire
J'ai entendu sur France Inter que les ventes de voitures électriques stagnent. D'après une étude, cela serait dû à des croyances sur leur bilan écologique. Une berline avec 60 kWh de batterie, comparée à son équivalent thermique, produira deux fois moins de CO₂ durant sa vie, de l'usine à la casse. Oui, la batterie ajoute du CO₂ à la construction, comme toute augmentation de poids, mais cela n'efface pas du tout les gains suivants.
Je veux vous faire part de mon retour d'expérience après un an en berline électrique et plusieurs années en citadine électrique.
Coûts, autonomie et usage au quotidien
Son coût
Leur prix est souvent montré du doigt. Il y a un an (cela a changé depuis), un bonus écologique s'appliquait aux voitures de moins de 45 000 €. Chaque constructeur avait son modèle sous ce seuil. Cela donnait une facture de 36 à 40 000 €.
Cela représente le double du budget de ma précédente voiture d’il y a 12 ans, je n’étais pas prêt. Une voiture thermique équivalente était facturée 32 000 €, mais avec un entretien annuel à payer, plus l'essence. En 2 ou 3 ans, la différence de prix est effacée.
Les voitures sont simplement devenues plus coûteuses.
L'usage
Les berlines électriques, avec 60 kWh de batterie, sont assez imposantes : 1,7 à 2 tonnes, une garde au sol basse, et une largeur de plus de 2 m. Les batteries prennent de la place. Cela racle dans certaines rampes de parking ou au-dessus d’un gendarme couché avec 4 personnes.
Ces batteries offrent autour de 400 km d'autonomie. Cela varie avec le poids et l'aérodynamisme. La consommation varie entre 13 et 20 kWh aux 100 km. Pour information, il y a 10 kWh d’énergie thermique dans 1 l d’essence (12 pour le diesel, et 8 pour l’éthanol, l’E85).
Les batteries de 80 ou 100 kWh sont évidemment bien plus lourdes, offrent plus d’autonomie et se chargent un peu plus rapidement.
À l’usage, l’autonomie n’est pas le plus important. Seule la vitesse de charge l’est vraiment. 15 min pour gagner 300 km d’autonomie n’a rien à voir avec 45. Si on respecte l’arrêt de repos toutes les 2 h lors des longs trajets, on a besoin de 200 km d’autonomie plus une marge. Les 4 h 30 de charge de la citadine ne posent pas de souci la nuit, mais ce n’est pas viable sur la route.
Une voiture électrique consomme par km et selon sa vitesse. Les embouteillages ne consomment rien. Par contre, l’autoroute oui. Les véhicules avec un bon S.Cx ne voient pas de différence entre le 110 et le 130 km/h (donc pas les SUV).
Les montées consomment, mais pas les descentes ; en comptant les deux, cela revient presque à du plat.
Le GPS intégré de ma voiture estime correctement sa consommation. J’avais un peu peur du "km-marketing" (unité équivalente à 850 ou 900 m). Ainsi, les recharges sont proposées dans le trajet. La voiture anticipe en chauffant la batterie pour augmenter la vitesse de charge. D’ailleurs, à froid, la voiture désactive la récupération d’énergie, et on sent bien son poids au freinage.
En montagne, après une semaine de parking et un déneigement, la voiture a perdu 12 kWh de charge. À cause du froid, la charge au freinage était limitée, mais la descente n’a presque rien consommé (1 % en 30 minutes).
La voiture présente plein de statistiques autour de la consommation. Je n’ai pas encore pu vérifier si les pertes à l’arrêt sont comptées. J’aimerais pouvoir comparer les kWh rentrés depuis la prise aux kilomètres parcourus.
La voiture consomme à l’arrêt, souvent sous votre contrôle : surveillance (10 %/jour !), chauffage du matin (2 % ? Mais c’est trop bien), autodécharge.
Recharge, contraintes techniques et confort d’utilisation
Sur un long trajet, j’utilise l’application ABRP pour choisir les arrêts afin de manger pendant la recharge, à la bonne heure. L’application permet de choisir entre des arrêts courts fréquents ou plus espacés.
Elle peut aussi servir à vérifier qu’un trajet que vous comptez faire souvent est bien équipé en bornes.
Le temps de charge
J’ai déjà fait un voyage de 3000 km dans l’est sans souci pour recharger. Pour aller en montagne, j’ai rechargé avant de monter. Le pire que j’ai attendu, c’est 15 min pour avoir une borne de recharge, moins que mes pires souvenirs de file à la station-service.
Les prix vont de 0,30 à 0,60 €/kWh selon l’heure et le réseau utilisé, soit 20 € le plein. À la maison, cela revient à 7 € en tarif de nuit (7,60 € en tarif rouge heure creuse). Les plages horaires se programment facilement, mais un effort pourrait être fait pour que la voiture optimise seule le coût de la charge.
Cela ne m’est jamais arrivé de chercher une borne en centre-ville, mais je connais quelqu’un qui a tourné longtemps à Lyon car les places avec bornes étaient occupées par des voitures garées.
Pour le quotidien, le branchement à la maison est un confort par rapport au thermique. Je charge une fois et demie par semaine, en gros une nuit et le week-end (22 000 km/an). J’essaie d’avoir une charge complète par semaine pour que la batterie équilibre ses éléments — c’est une recommandation constructeur. Il n’est pas conseillé de charger à plus de 8 A (2 kW) depuis une prise classique : ce n’est pas fait pour une telle puissance en continu, et cela chauffe. Les rallonges sont proscrites car le câble a un capteur de température pour couper en cas de surchauffe : il ne peut pas détecter la température de l’autre côté.
À la maison, j’ai une prise simple spécifique Legrand de 13 A (3 kW), il existe maintenant des prises 16 A au même prix. Une borne 7 kW coûte de 500 à 1000 €.
Avec un peu d’anticipation, on gère deux véhicules sur cette prise.
Le câble classique 220 V fourni se comporte comme une borne de recharge. On devrait donc pouvoir intervertir les câbles des deux voitures, mais on n’a jamais essayé.
Vu que le câble est vu comme une borne, une borne communique avec la voiture. On branche donc le 220 V en premier et on le retire en dernier. Sinon, la voiture en déduit qu’il y a une coupure de courant. En pratique, cela ne change pas grand-chose.
Il n’y a plus que la norme de prise CCS type 2 (et le 220 V) qui est présente partout. Les superchargeurs rajoutent 2 fiches supplémentaires (1000 V) “CCS type 2 combo”, mais restent physiquement compatibles avec l’ancienne norme.

Une borne de recharge de base se limite à 32 A en triphasé pour certaines voitures (3×32×230) soit 22 kW. Le triphasé ou le 32 A n’est pas forcément supporté. Cela limite à 11 kW (3×16×230) ou 14 kW (64×220). Mais ces modes de charge ont peu d’intérêt à mes yeux : trop rapides pour une nuit, trop lents sur la route. En plus, il faut le compteur EDF et le contrat adaptés. Un gros rouleur avec une grosse batterie y trouvera peut-être un intérêt (>400 km/jour).
La puissance max de charge ne présume pas du temps de charge total. C’est uniquement le point de départ. Certaines voitures commencent à 250 kW mais baissent vite et sont plus lentes au 20%-80 % que des voitures dont le pic ne dépasse pas 170 kW. Il faut vraiment regarder le temps de charge réel d’un modèle (voiture-propre.fr) pour l’évaluer.
Les superchargeurs annoncent 150, 250, 400 kW. C’est le maximum pour une borne, mais aussi pour un groupe de 2 ou 4 bornes. Donc, vous êtes tranquilles à 140 kW sur la borne “3a” annoncée à 150, mais limitée par la voiture, puis une autre voiture se branche à la borne “3b” et vous tombez à 75 kW. La charge finit autour de 20 kW, donc cela ne double pas le temps de charge, mais on peut perdre 5 min.
Il est parfois difficile de connaître le prix d’une borne dans la rue : le tarif n’est jamais marqué dessus, seulement dans les applications. Il y a encore peu de bornes payables directement par carte bleue, et dans ce cas, vous ne connaissez pas le tarif appliqué. Pourquoi ne peut-on pas avoir le prix affiché et payer en CB ou autre carte, comme pour l’essence ?
Si on ne peut pas charger sa voiture chez soi, cela me semble problématique, surtout que les charges rapides usent la batterie plus rapidement.
Enedis commence à faire des accords avec les copropriétés pour mettre une prise et un compteur aux places de parking. Je pense que c’est vraiment le frein principal pour choisir un VE.
L'entretien
La voiture a beaucoup moins de rendez-vous techniques qu’une thermique, sa mécanique étant simple. Même les freins s’usent peu, le freinage par récupération d’énergie étant très puissant.
Il faut signaler l’absence de roue de secours. Si le cric est mal positionné, on pourrait percer la batterie et provoquer un incendie. Cela fait aussi du poids mort supplémentaire et de la batterie en moins. Beaucoup de constructeurs de voitures électriques ne la proposent pas.
Satisfait
Globalement, je n’ai pas envie de revenir en arrière. Les odeurs d’hydrocarbures ou d’échappement ne me manquent pas du tout. Le silence est appréciable, surtout à basse vitesse. Et les voitures sont performantes et amusantes à conduire.
Cet article relate un exemple avec deux voitures, j’imagine que l’on peut avoir des expériences différentes, que je vous propose de partager en commentaires.
- Source de composition de prix de CO₂ pour une voiture électrique et une voiture thermique - https://cumin.univ-lille.fr/fact-sheets/acv-des-vehicules-electriques-in-french
- ENEDIS : la recharge des véhicules dans les copropriétés - https://www.enedis.fr/mobilite-electrique-enedis-accompagne-la-recharge-des-vehicules-dans-les-coproprietes
- ABRP en ligne - https://abetterrouteplanner.com/
- Temps de charge d'une voiture ("Automobile propre") - https://www.automobile-propre.com/simulateur-temps-de-recharge-voiture-electrique/
Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur