Le président de la République italienne Sergio Mattarella vient de nommer l’ancien directeur de la Banque centrale européenne Mario Draghi pour former un gouvernement “apolitique”. Une décision qui s’inscrit dans une longue série d’administrations technocratiques destinées à imposer des mesures d’austérité impopulaires et pourtant rejetées par les Italiens. Le sociologue Paolo Gerbaudo, déjà interviewé par Le Vent Se Lève , nous livre son analyse sur cette spécificité politique italienne et ses enjeux. Article de notre partenaire Jacobin , traduit et édité par William Bouchardon.
L’Italie est depuis longtemps le laboratoire de toutes sortes d’expériences réactionnaires, du régime fasciste de Benito Mussolini au populisme de droite vaniteux de Silvio Berlusconi, précurseur de Donald Trump. Mais au cours des dernières décennies, le belpaese (“beau pays” en italien, ndlr) est également devenu le terrain d’essai de la forme la plus extrême de néolibéralisme : des gouvernements technocratiques dirigés par des économistes austéritaires. Entre 2011 et 2013, le gouvernement de Mario Monti, ancien conseiller de Goldman Sachs, a ainsi mis en place de douloureuses mesures d’austérité contre la volonté populaire des Italiens. Aujourd’hui, l’establishment politique italien veut renouveler l’expérience, mais sous une autre forme.
L’Italie traverse actuellement une impasse politique, le Premier ministre de coalition sortant, Giuseppe Conte, n’ayant plus de majorité pour gouverner. Pour sortir de la crise, le président Sergio Mattarella a chargé l’ancien directeur de la Banque centrale européenne Mario Draghi de former une nouvelle administration . Or, Draghi est l’un des architectes de l’austérité européenne, ainsi que le responsable des mémorandums qui ont dévasté l’économie grecque.
La nomination de Draghi, faite sans aucune référence à une quelconque élection ni même aux principaux partis politiques, ressasse les éternels éléments de langage sur la soi-disant cure de “responsabilité fiscale” destinée à améliorer la “réputation internationale” de l’Italie. Mais, au lendemain de la pandémie, il s’agit aussi d’une tentative des milieux d’affaires de mettre la main sur les investissements du Fonds européen de relance économique pour orienter ces fonds vers les entreprises plutôt que vers l’aide destinée aux citoyens ordinaires.
Matteo Renzi, expert en magouilles politiques
Le nouveau gouvernement proposé par Draghi, actuellement en recherche de majorité au Parlement, intervient après la crise du gouvernement Conte II. A partir de juin 2018, Conte a dirigé une coalition comprenant les populistes du Mouvement Cinq Etoiles (M5S) et la Lega de Matteo Salvini. A partir de septembre 2019, Conte s’est appuyé sur le M5S, le Partito Democratico (PD) de centre-gauche, le petit parti de gauche Liberi e Uguali, et le parti centriste néolibéral Italia Viva.
En janvier, alors que la pandémie faisait toujours rage, Italia Viva, le parti des élites financières italiennes dirigé par l’ex Premier ministre Matteo Renzi (2014-2016), a finalement mis le gouvernement à genoux . De toute évidence, même les mesures sociales modérées promues par Conte, comme la renationalisation partielle des autoroutes , ont été considérées comme inacceptables par les milieux d’affaires italiens.

Matteo Renzi, ancien Premier ministre centriste et chef du parti Italia Viva. © Free World and Friends World
Né d’une scission du PD, dirigé par Renzi entre 2013 et 2018, le parti Italia Viva est extrêmement impopulaire : les sondages lui donnent 3 % des intentions de vote. Pourtant, la formation politique contrôle une poignée de sénateurs dont les voix sont décisives pour la majorité de Conte. La politique italienne ressemble parfois à un film d’espionnage rempli de personnages machiavéliques : juste avant de déclencher la crise politique, Renzi a rendu visite à un de ses amis politiques actuellement en prison pour corruption, l’ancien sénateur Denis Verdini, dont la fille est par ailleurs la fiancée de Matteo Salvini. Renzi est également entouré d’alliés internationaux pour le moins douteux comme Tony Blair. Alors que l’Italie traverse une grave crise, Renzi s’est envolé vers l’Arabie Saoudite pour une conférence payante au cours de laquelle il a loué le “grand, grand” prince héritier Mohammed bin Salman, malgré son implication dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, le massacre au Yémen et le soutien saoudien à la dictature en Egypte ayant conduit à la mort du jeune chercheur italien Giulio Regeni en 2016 .
Alors qu’il avait initialement soutenu la création du gouvernement Conte II en 2019, le petit parti de Renzi a agi davantage comme une opposition interne au gouvernement que comme un allié. Il a vivement critiqué les mesures sociales modérées mises en place par Conte, à commencer par le “revenu citoyen”, un transfert gouvernemental qui aide environ un million de familles italiennes en situation d’extrême pauvreté.
Renzi voulait créer un chaos politique qui forcerait l’establishment italien au remède habituel des moments de crise : un gouvernement technocratique mettant en œuvre les “réformes” exigées par l’UE et le monde des affaires.
En outre, Renzi a souvent insisté pour que l’Italie demande un prêt au mécanisme européen de stabilité (MES), destiné aux pays en difficulté financière. Le M5S s’y est fortement opposé, par crainte des conditions qui seraient imposées par les créanciers, et a rappelé qu’aucun autre pays européen n’a l’intention d’utiliser ces prêts. Après avoir lancé plusieurs ultimatums depuis son compte Twitter, Matteo Renzi a finalement décidé de faire tomber le gouvernement de M. Conte, en demandant aux deux ministres d’Italia Viva de démissionner.
Certains observateurs estimaient que Renzi voulait simplement plus de ministères et davantage de pouvoir au sein de la coalition existante. Mais, très vite, il est apparu que ses demandes exorbitantes n’étaient qu’une ruse pour mettre fin au gouvernement Conte. Derrière cette décision, Renzi avait trois objectifs. Premièrement, renverser Conte, devenu bien trop populaire à son goût et bénéficiant toujours du soutien d’environ la moitié des Italiens. Deuxièmement, désorganiser le projet politique de centre-gauche du PD et du M5S, qui pouvait réunir un large bloc social composé de travailleurs précaires (M5S) et de fonctionnaires, ainsi que de retraités (PD). Enfin, Renzi voulait créer un chaos politique qui forcerait l’establishment italien au remède habituel des moments de crise : un gouvernement technocratique mettant en œuvre les “réformes” exigées par l’UE et le monde des affaires. Avec la nomination de Draghi, tous ces objectifs sont désormais atteints.
Les technocrates au pouvoir : une passion pour l’austérité
Les gouvernements dits “techniques” sont un affront évident à la démocratie. Il s’agit en effet de la manifestation la plus extrême de la tendance post-démocratique. Ce concept , développé notamment par le politologue Colin Crouch, explique la trajectoire des démocraties capitalistes depuis la fin de la Guerre Froide, où la démocratie se résume de plus en plus à une façade et où le véritable pouvoir n’appartient plus aux élus.
Il faut différencier deux types de situations : avoir un gouvernement dépendant du travail d’experts soi-disant apolitiques dans ses ministères et agences, et avoir un gouvernement directement dirigé par un technocrate non élu. L’Italie est l’un des rares pays occidentaux où une telle chose est non seulement considérée comme acceptable, mais est même devenue une sorte de tradition.
Les politologues Duncan McDonnell et Marco Valbruzzi ont recensé vingt-quatre gouvernements dirigés par des technocrates en Europe entre la Seconde Guerre mondiale et 2013. Si la Grèce et la Roumanie sont les pays les plus touchés, avec cinq gouvernements chacun, l’Italie n’est pas loin derrière : avec Draghi, ce sera la quatrième fois que les technocrates gouvernent directement l’Italie. Surtout, les gouvernements technocratiques italiens n’existaient pas avant une trentaine d’années. Apparus avec la chute de la Première République au début des années 1990, ces expériences politiques ont systématiquement conduit à des politiques d’austérité sévères.
Le premier gouvernement dirigé par des technocrates a été formé par Carlo Azeglio Ciampi en 1993. Gouverneur de la banque centrale italienne dans les années 1980, Ciampi avait contribué à démolir le consensus keynésien, prônant l’indépendance de la banque centrale à l’égard du politique et l’équilibre budgétaire. Une fois premier ministre, il a promu le premier cycle de privatisation massive des actifs de l’État. Il mit par exemple fin à la participation de l’État dans les grandes banques, la compagnie d’électricité Enel et la compagnie pétrolière Agip, tout en pratiquant une “politique des revenus” exerçant une pression à la baisse sur les salaires. Autant de sacrifices destinés à prouver que l’Italie rentrait dans les critères requis pour participer au processus de création de l’euro.
Quelques années plus tard, ce fut le tour de Lamberto Dini, premier ministre entre 1995 et 1996. Comme Ciampi et Draghi, il était également issu de la banque centrale italienne, dont il a été le directeur général. Dini est devenu Premier ministre après la chute du premier exécutif dirigé par Silvio Berlusconi et a poursuivi la doctrine de privatisations et de “responsabilité fiscale” inaugurée par Ciampi, en imposant par exemple une importante réforme des retraites.
La chute du dernier gouvernement de Silvio Berlusconi à l’automne 2011 a vu un autre technocrate, Mario Monti, devenir premier ministre. Silvio Berlusconi, magnat milanais des médias, fut alors débarqué du pouvoir à la hâte en raison de la spéculation des marchés financiers contre les obligations italiennes et de son implication dans un scandale sexuel avec une prostituée mineure. Sa sortie du pouvoir ressemblait à une ingérence étrangère : elle a eu lieu après une lettre féroce écrite par Draghi, alors gouverneur de la BCE, et une conférence de presse conjointe de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français Nicolas Sarkozy, où les deux chefs d’Etat exprimaient sans détour leur souhait de voir Berlusconi être démis de ses fonctions.
Au pouvoir, Monti s’est comporté comme s’il était encore commissaire européen, tel un gouverneur colonial envoyé pour rétablir l’ordre dans une région indisciplinée de l’empire.
Malgré toute la corruption et les pitreries de Berlusconi, les Italiens ont vite compris que les choses pouvaient encore empirer. Pour remplacer Berlusconi, Giorgio Napolitano, le président de l’époque, choisit Mario Monti, un professeur d’économie de l’université Bocconi de Milan, l’équivalent italien de l’école de Chicago, c’est-à-dire un repère de fanatiques du néolibéralisme. De 1995 à 2004, Monti avait été commissaire européen, responsable d’abord du marché intérieur, des services, des douanes et de la fiscalité, puis de la concurrence. Comme à chaque fois avec les gouvernements technocratiques, son rôle était de “sauver l’Italie”.
Au pouvoir, Monti s’est comporté comme s’il était encore commissaire européen, tel un gouverneur colonial envoyé pour rétablir l’ordre dans une région indisciplinée de l’empire. Il a administré l’intégralité de la “cure” d’ajustement structurel recommandée par Bruxelles, aggravant fortement l’état de l’économie italienne, déjà en stagnation depuis des années en raison des règles budgétaires restrictives de l’UE. A travers un pack de mesures dénommé de façon méprisante “Salva Italia” (Sauver l’Italie), il a réduit les dépenses publiques à néant. Concrètement, cela s’est matérialisé par des coupes dans les retraites publiques, mais aussi de fortes baisses du budget de la santé, dont des conséquences sautent désormais aux yeux dans le contexte de la crise du COVID-19.
Dans une interview sur CNN, Monti a affirmé que son objectif premier était de “supprimer la demande intérieure” en baissant les salaires afin d’améliorer la “compétitivité internationale”. Sans surprise, les Italiens n’ont guère apprécié. A la fin de la législature en 2013, son gouvernement plafonnait à 25 % d’approbation et son parti centriste, Scelta Civica, n’obtenait que 8 % des voix aux élections la même année.
Que va faire “Supermario” ?
Compte tenu des expériences précédentes, le gouvernement Draghi s’annonce inquiétant. Certes, Draghi peut sembler moins néolibéral que Monti : son mandat à la BCE entre 2011 et 2019 a été applaudi par la presse libérale pour avoir sauvé la zone euro. Sa fameuse promesse de faire “tout ce qu’il faut” pour éviter la dislocation de la zone monétaire, principalement grâce à un programme massif de rachats d’actions dit quantitative easing qui perdure encore, a ainsi mis un terme à la spéculation financière sur les obligations des Etats européens, lui valant le surnom de “Supermario”.

Mario Draghi, alors gouverneur de la BCE, au Forum Economique Mondial de Davos en 2012. © World Economic Forum
Toutefois, il ne faut pas oublier que Draghi a été l’un des architectes de l’austérité au lendemain de la crise de 2008. Sa politique de rigueur budgétaire a étranglé de nombreuses économies européennes, notamment celles du Sud. De plus, les programmes d’assouplissement quantitatif mis en place sous sa direction, loin de pomper des ressources dans l’économie réelle, n’ont fait que gonfler les actifs sur les marchés financiers. Au final, l’économie allemande en a été la grande gagnante, grâce à la dévaluation de la monnaie.
Certains propos récents de Draghi peuvent amener à penser qu’il a tiré les leçons de l’échec de l’austérité. Dans un célèbre éditorial du Financial Times de mars 2020 , l’ancien gouverneur de la BCE a ainsi déclaré qu’il fallait accepter jusqu’à nouvel ordre l’existence de dettes publiques élevées. En août, s’exprimant lors de la réunion annuelle du groupe catholique de droite Comunione e Liberazione, il a soutenu que les États devaient créer des “bonnes dettes”, c’est-à-dire des investissements dans les infrastructures productives. Ce changement de rhétorique rejoint les positions d’autres leaders du monde financier comme Kristalina Georgieva, l’actuelle directrice du Fonds monétaire international, qui a demandé aux gouvernements de “dépenser autant que possible”. Mais ne nous y trompons pas : il ne s’agit de rien d’autre que des mesures visant à sauver du désastre un capitalisme défaillant.
En tant qu’ancien employé de Goldman Sachs, Draghi aura la responsabilité de gérer les deux cents milliards d’euros mis à disposition par l’Union européenne par le biais du fonds de relance. Il est probable qu’une partie considérable de ces fonds seront distribués aux grandes entreprises représentées par la Confindustria, l’équivalent italien du MEDEF. Sans surprise, la Confindustria est un des plus grands soutiens de Draghi.
Selon toute vraisemblance, Draghi satisfera les grands patrons, laissant des centaines de milliers d’Italiens tomber dans le chômage et la pauvreté.
Draghi n’aura probablement ni le temps ni le courage politique nécessaires pour abroger certaines politiques sociales comme le “revenu citoyen” (bien qu’il puisse en restreindre l’accessibilité) et imposer de nouvelles réductions des dépenses publiques. Mais il tentera sans doute de remettre l’économie italienne sur la voie de la “responsabilité fiscale” dont cette dernière s’est écartée depuis la crise du coronavirus, du moins s’il en croit les institutions européennes.
L’arrivée au gouvernement de Draghi va certainement signifier le non renouvellement de l’interdiction temporaire de licenciements, introduite en mars 2020 et devant prendre fin dans deux mois. Il s’agit là d’une des mesures les plus sociales mises en œuvre par le gouvernement Conte durant la pandémie, obligeant les entreprises privées à assumer une partie des coûts économiques de la crise. Mais la Confindustria ne cesse de réclamer le retour du privilège fondamental de l’entrepreneur : le droit de licencier des travailleurs. Selon toute vraisemblance, Draghi satisfera les grands patrons, laissant des centaines de milliers d’Italiens tomber dans le chômage et la pauvreté.
Désormais, la vraie question est celle de la réaction des forces politiques italiennes et des citoyens ordinaires face à cette dérogation scandaleuse aux principes démocratiques et à cette nouvelle tentative de subordonner la politique italienne à la responsabilité fiscale exigée par Bruxelles. Le parti démocrate a toutes les chances de suivre les appels à la “responsabilité” de Mattarella, lui-même issu de ce parti. Une majorité parlementaire pourrait être trouvée avec les votes du PD, de la Lega, de Forza Italia (parti de Berlusconi, ndlr), et des carriéristes qui abondent au Parlement italien.
Le Mouvement 5 Etoiles représente la seule formation politique qui puisse oser dire non, même si ce scénario est peu probable. Refuser de soutenir Draghi pourrait aider les 5 Etoiles à retrouver une partie de sa crédibilité auprès des Italiens, sérieusement abîmée après trois ans au gouvernement dans le cadre de deux coalitions différentes. D’ores-et-déjà, les Italiens sont en colère contre les manœuvres politiques de Renzi et le chaos qu’il a provoqué en pleine pandémie. Malgré le virus, les manifestations de différents groupes se succèdent depuis un an. Si Draghi ne se montre pas prudent, il pourrait se voir confronté non seulement à une urgence sanitaire et économique, mais aussi à une crise de l’ordre public.
Dans ce lugubre panorama, le seul espoir repose sur les citoyens, qui sont demeurés pour la plupart passifs pendant cette crise, mais qui pourraient se réveiller. Si cela ne se produit pas, un gouvernement réactionnaire dirigé par la Lega de Salvini et les Frères d’Italie post-fascistes de Giorgia Meloni a de bonnes chances de remplacer les technocrates lors des prochaines élections. Cette situation désastreuse est le résultat des calculs politiques de centristes corrompus ainsi que de la tendance de l’establishment italien, en temps de crise, à faire appel à des technocrates, plutôt que de convoquer des élections et de laisser le peuple décider du type de politique économique qu’il préfère.
L’article Italie : le gouvernement technocratique de Draghi est une insulte à la démocratie est apparu en premier sur lvsl.fr - Tout reconstruire, tout réinventer .
 chevron_right
chevron_right
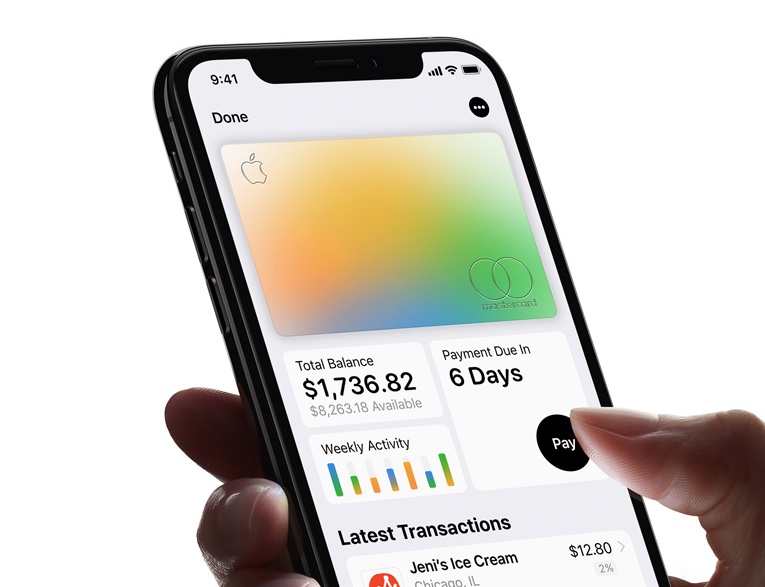

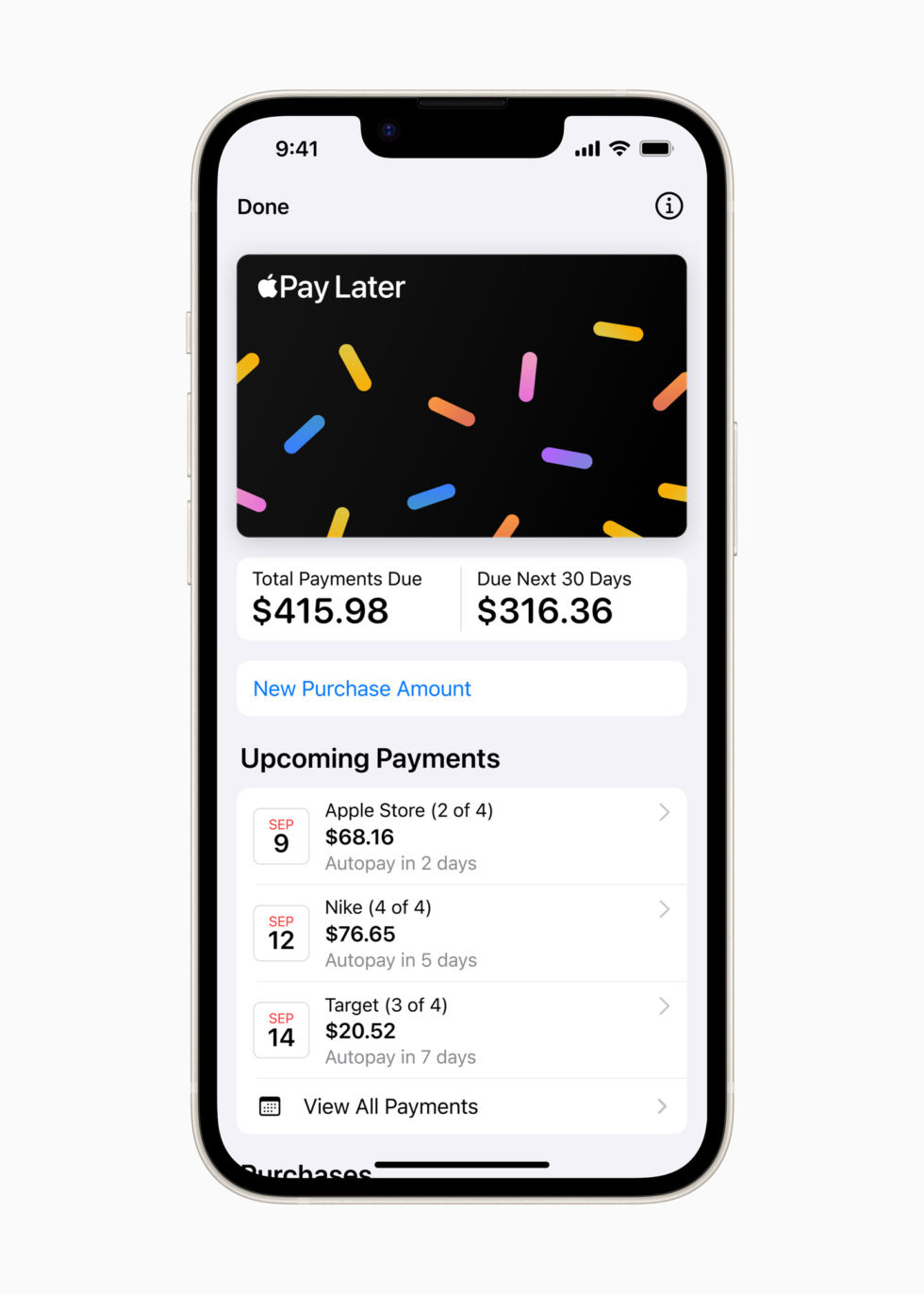
 Matteo Renzi, ancien Premier ministre centriste et chef du parti Italia Viva. © Free World and Friends World
Matteo Renzi, ancien Premier ministre centriste et chef du parti Italia Viva. © Free World and Friends World Mario Draghi, alors gouverneur de la BCE, au Forum Economique Mondial de Davos en 2012. © World Economic Forum
Mario Draghi, alors gouverneur de la BCE, au Forum Economique Mondial de Davos en 2012. © World Economic Forum